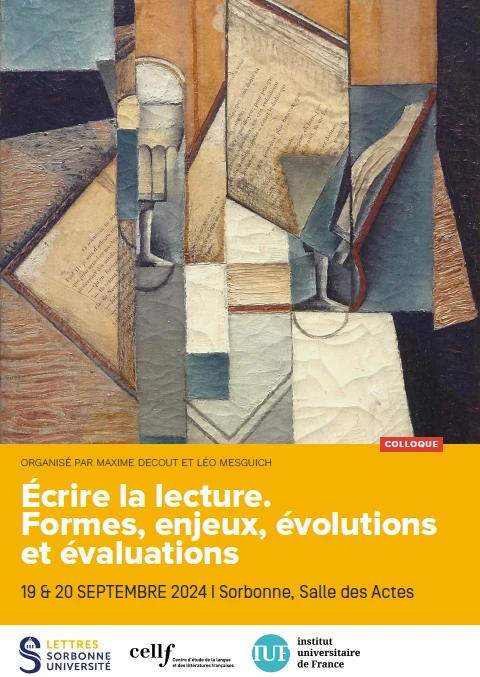9h15 : Accueil café
9h40 : Ouverture de la journée
9h45-10h15 : Séance d’introduction par Charlotte Détrez (Sorbonne Université, CELLF) et Erick Miceli (Université de Corse)
10h15-12h : Première session
Alexandre Goderniaux (Bibliothèque nationale de France-ULiège, U.R. Transitions) : « Contraindre le roi à une guerre sainte. Les libelles imprimés par les catholiques zélés durant les guerres de Rohan (1620-1629) »
Didier Crémades (Université Lyon II) : « 127 mesures contre la peste : l’arrêt du Parlement de Provence du 17 juillet 1629 »
Dorian Varenne (Sorbonne Université, Centre Roland Mousnier) : « De Jure exclusivae : défense et condamnation du droit des couronnes à empêcher l’accession d’un cardinal au trône de Saint Pierre dans les traités de la Curie »
12h-14h : Déjeuner
14h15-16h : Seconde session
Ana Carmona Aliaga (EPHE-PSL) : « La contestation par les passions. Les réactions à la révocation de l’édit de Nantes : Bayle, Jean Claude et Jurieu »
Pietro Piccin (EHESS-Università degli Studi di Firenze) : « Contester la papauté dans l’Italie du Seicento : la publication du libelle du duc de Parme dans la guerre de Castro (1641-1644) »
Jean-Benoît Poulle (Sorbonne Université, Centre Roland Mousnier) : « Écrire pour garder la mémoire de la contestation : la mise en débats du pouvoir monarchique au prisme des journaux des parlementaires frondeurs Jean le Boindre et Pierre Lallemant (1648-1652) »
16h-16h15 : Pause
16h15-17h : Séance de discussion avec les intervenants
17h : Conclusion de la journée
Pour suivre la journée en visioconférence, contactez : ecritspouvoir2024@gmail.com