Rencontre avec Perrine Coudurier, docteure, membre du CELLF 19-21, à propos de la publication de son essai La Terreur dans la France littéraire des années 1950 (1945‑1962) (Classiques Garnier, mai 2021), version remaniée de sa thèse.
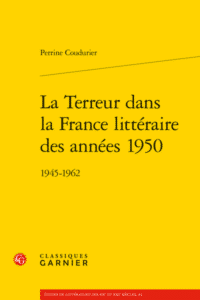
Quel a été votre cheminement pour déterminer et affiner votre sujet de thèse ?
Après un master 1 consacré à Marguerite Duras, j’ai voulu poursuivre mon exploration des nouveaux romanciers à travers les questions inextricables de désir et de mal. J’ai approfondi ces notions dans mon travail de master 2, et me suis intéressée au concept de terreur développé notamment par Paulhan afin de resserrer ma problématique.
La thématique du Mal qui imprègne et parcourt la littérature d’après‑guerre, a été pensée sur le plan philosophique. Vous posez les termes du questionnement que soulèvent Arendt et Sartre mais également Hegel avant eux. Est-ce qu’on ne peut appréhender la Terreur dans les lettres qu’en en posant les soubassements philosophiques ?
L’objectif de ma thèse était de peindre une génération d’écrivains, celle des années cinquante, de voir quelles étaient leurs lectures et ce qui se disait dans les revues, de cerner au plus près le champ de pensée de ces années-là. Ma thèse est volumineuse car il s’agissait de faire de l’histoire culturelle autant que de l’histoire littéraire pour poser les jalons du contexte intellectuel de l’époque. J’ai étudié les philosophes les plus importants pour ma période, comme Hegel, et spécifiquement le mal de la Seconde guerre mondiale tel que le conceptualise Arendt.
C’est un gros travail de mise en perspective !
Il le fallait pour analyser le contexte et retracer les débats de l’époque. Ma première partie est philosophique et historique. J’ai également été influencée par des sociologues comme Gisèle Sapiro ou par les travaux d’Anne Simonin, qui travaillent toutes deux à mettre en rapport l’histoire, la pensée, la littérature et la sociologie.
La « Terreur dans les lettres » est un motif conceptualisé par Jean Paulhan, qui lui oppose la rhétorique dans un sens bien particulier. Pouvez-vous expliciter cette notion clé pour ce travail de thèse ?
La lecture de l’essai de Jean Paulhan Les Fleurs de Tarbes ou la Terreur dans les Lettres (publié en 1941), a été très importante pour mon travail de thèse ; c’est un texte abscons, métaphorique, mélangeant littérature et politique. Il est souvent difficile de comprendre de qui parle Paulhan quand il évoque les rhétoriqueurs et les terroristes. Mais c’est un texte intéressant à mettre en avant : Paulhan est en effet capital pour les années cinquante. Quand j’ai commencé ma thèse, il ne faisait pas l’objet de nombreux travaux.
Pour Paulhan, grand éditeur des années cinquante, il y a deux façons opposées d’aborder la littérature ; d’abord la terreur — chaque génération d’écrivains cherche une nouvelle façon de s’approprier la réalité au risque de l’hermétisme ; les surréalistes, qui veulent créer un nouveau langage, en font partie. Il y oppose les tenants de la rhétorique, héritage de la pensée classique, qui utilise des « lieux communs », des types de récits qui assurent une continuité et des repères pour l’histoire de la littérature française.
Paulhan cherche une troisième voie, dont on ne voit pas l’aboutissement dans son travail, inachevé. Je me suis servie de ce prisme pour classer les œuvres de mon corpus, le Nouveau Roman pouvant investir éventuellement la troisième voie.
Comment le Nouveau Roman, justement, très présent dans la période considérée, investit-il le champ de la Terreur ?
Il faut aller à contre-courant de l’idée fausse que le Nouveau Roman est déconnecté de la réalité et s’adresse uniquement à des universitaires ou à un lectorat averti. Le Nouveau Roman, comme l’a analysé Nelly Wolf notamment dans son essai Une littérature sans histoire. Essai sur le Nouveau Roman (Droz, 1995) est le reflet d’une époque. Pour moi, je voulais voir le mal rejoué par le Nouveau Roman de façon métaphorique mais bien réelle, et qui l’ancre dans une vraie problématique philosophique.
À l’intérieur du Nouveau Roman, on peut lire à la fois une forme d’hermétisme et des lieux communs du roman français.
Deux figures littéraires (Sade et Kafka), hors champ par rapport à la période considérée, traversent, selon vous, nombre d’œuvres de la littérature post-Seconde guerre mondiale. Pouvez-vous nous expliquer le pourquoi de cet engouement ?
Bien qu’en dehors de la chronologie, Sade apparaît comme une référence de premier plan de la pensée de Bataille et de Blanchot, dans la manière de réinvestir le mal. Le procès de Jean-Jacques Pauvert, qui réédite Sade dans l’après-guerre, est l’occasion de repenser le sujet de la littérature et du mal. Un débat important a lieu à ce moment-là avec des prises de position fortes chez les auteurs favorables à la publication. Le lien entre nazisme et Sade a été établi et instruit plus tard en revanche.
Kafka quant à lui influence directement Robert Pinget : son roman L’Inquisitoire (1962) fait référence dans sa structure au Procès de Kafka. La Colonie pénitentiaire est également un récit qui est relu en écho aux atrocités perpétrées pendant le conflit mondial. Kafka est en filigrane dans plusieurs récits de camps que j’ai aussi explorés, chez Primo Levi par exemple.
La question de la légitimité de la « littérature noire » fait débat à l’époque : dépeindre la cruauté peut‑il être une ambition littéraire ? Le débat est lancé en 1946 par des intellectuels communistes dans la revue Action à travers la question provocatrice « Faut-il brûler Kafka ? »
Venons-en à la chronologie de votre travail de thèse : de combien de temps avez-vous eu besoin pour documenter, analyser, rédiger, et arriver au bout de ce travail ambitieux ?
Entre le dépôt du sujet et la soutenance, il m’a fallu six années de travail, avec une charge d’enseignement en tant que doctorante contractuelle d’abord et attachée d’enseignement ensuite (Ater) dans plusieurs universités.
Le dépouillement des revues — grande investigation solitaire de visionnage de microfilms en bibliothèque — a été un moment dense du travail de recherche. S’il faut essayer de quantifier, les deux tiers du travail ont été consacrés à la recherche pure et le reste du temps à la rédaction, même si, pendant cette dernière période, je ne me coupais pas totalement de mes recherches et restais en éveil sur mes problématiques.
Quel a été le rôle du directeur de thèse pendant ce parcours ?
Il a été déterminant pour borner le corpus, la chronologie (du procès Nuremberg au procès Eichmann) et la thématique, qui est celle de la terreur nazie à l’exclusion d’autres terreurs que j’aurais pu traiter aussi (stalinienne, algérienne). Nous avons eu des échanges riches et mon directeur de thèse m’a aidée à bien cerner les enjeux. Un directeur de thèse est une sorte de « coach » qui permet de redonner de l’élan quand cela est nécessaire et de mieux percevoir les échéances : je voulais soutenir plus tôt mais il a considéré qu’il fallait encore de la maturité pour faire aboutir mon travail et en définitive, il a eu raison car cela a permis d’affiner les analyses et de produire un travail satisfaisant. L’étape de relecture finale et les retours circonstanciés de sa part ont été très précieux.
De la thèse au livre, y a-t-il eu un nouveau travail éditorial ?
Il a fallu réduire drastiquement le volume des notes lorsqu’elles étaient bibliographiques ; j’ai aussi concentré quelques analyses textuelles. J’aurais aimé resserrer davantage encore mon propos pour rendre la publication plus accessible mais c’est une entreprise qui aurait nécessité une nouvelle approche.
Quel a été votre parcours professionnel jusqu’à aujourd’hui ?
J’ai été ATER à l’université Paris-Descartes après la thèse, puis j’ai effectué six années dans le secondaire à Nanterre, en collège. J’ai toujours assuré parallèlement des vacations à l’université car j’aime m’adresser aux étudiants. Je fais aussi partie du jury de concours de l’ENS.
Je collabore depuis plus de dix ans à Fabula, site de recherche en littérature, en faisant de la veille éditoriale et de la relecture de comptes rendus critiques pour la revue Acta fabula.
Aujourd’hui, je suis détachée à plein temps pour Fabula, qui a remporté un appel d’offres pour obtenir un poste, afin de développer et de professionnaliser ses projets éditoriaux.
Entretien réalisé par Pascale Langlois, ingénieure d’études CELLF, école doctorale 3





